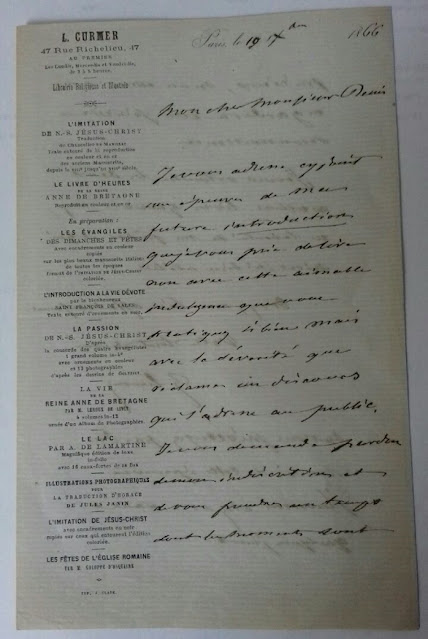Paris, le 19 IXbre (= novembre) 1866
Mon cher Monsieur Denis
Je vous adresse cy joint
une épreuve de ma
future introduction
que je vous prie de lire
non avec cette aimable
indulgence que vous
pratiquez si bien mais
avec la séverité que
réclame un discours
qui s’adresse au public.
Je vous demande pardon
de mon indiscretion et
de vous prendre un temps
dont les moments sont
…/…
précieux, mon cœur vous
en gardera une sincère
reconnaissance.
Je vous retourne les deux
excellens livres que vous avez
eu la bonté de me prêter et qui
m’ont été bien utiles
Croyez moi bien affectueusement
Votre tout devoué
L. Curmer
Ne vous préoccupez pas du
renvoi de cette épreuve
j’enverrai chez vous dans
quelques jours
Une lettre à Monsieur Denis
Quand Léon Curmer ressuscite Jean Fouquet
Les plus anciens lecteurs de
ce blog se rappellent peut-être les cinq articles que Bertrand a bien voulu
faire paraître, de novembre 2011 à mars 2015, sur l’éditeur Léon Curmer (1801-1870) :
·
http://le-bibliomane.blogspot.fr/2011/11/leon-curmer-1801-1870-editeur-celebre.html
Le Bibliomane. Novembre 2011. Léon Curmer, éditeur célèbre, homme méconnu ;
·
http://le-bibliomane.blogspot.fr/2012/07/souvenir-de-leon-curmer-1801-1870.html
Le Bibliomane. Juillet 2012. Souvenir de Léon Curmer ;
·
http://le-bibliomane.blogspot.fr/2013/01/les-dessous-dun-billet-autographe-de.html
Le Bibliomane. Janvier 2013. Les dessous d'un billet autographe de Léon
Curmer ;
·
http://le-bibliomane.blogspot.fr/2013/10/une-lettre-inedite-de-leon-curmer.html
Le Bibliomane. Octobre 2013. Une lettre inédite de Léon Curmer ;
·
http://le-bibliomane.blogspot.fr/2015/03/le-reve-du-jaguar-un-achat-hasardeux.html
Le Bibliomane. Mars 2015. Le rêve du jaguar.
Une récente trouvaille
m’incite à enrichir cette chronique. Si vous le voulez bien, faisons dans le
temps un grand bond non pas en avant – cela s’est déjà si mal terminé !… – mais, plus prudemment, un siècle et demi en
arrière. Sans partir pour la Chine maoïste, nous resterons en France, plus
précisément dans le Paris impérial de Napoléon III.
L’automne 1866 dépouille les
frondaisons. Saison des feuilles mortes pour le poète mais espoir quasi
printanier d’un prochain livre pour Léon Curmer. En effet, l’éditeur s’apprête
à faire imprimer une monumentale Œuvre de
Jehan Foucquet. En matière d’art, les Français d’alors ne connaissent guère
qu’un académisme ankylosé dans l’idolâtrie séculaire de l’Antiquité
gréco-romaine. Léon Curmer va leur faire découvrir la fraîcheur pleine de verve
d’un peintre assis à son chevalet quatre siècles plus tôt, quand s’achève le
Moyen Âge.
Un peintre exceptionnel
De Jean Fouquet, nous savons
assez peu de choses. Il naît vraisemblablement à Tours, vers 1420. Sa venue au monde coïncide donc à peu près avec la
signature du traité de Troyes.
Manigancé non par la volage Isabeau de Bavière[1], comme
on nous l’a appris en classe, mais par le rancunier Philippe le Bon[2], duc de
Bourgogne et, à l’occasion, prince de l’Intrigue, cet accord diplomatique a été
stigmatisé par les historiens d’autrefois comme honteux. De fait, il
dépossède le soi-disant dauphin –
futur Charles VII[3]
– de son droit dynastique à la couronne de France au profit des ambitions
anglaises. C’est l’une des périodes les plus sombres de notre Histoire, aussi
noire que cette peste qui ravage l’Europe. Le royaume capétien frôle un gouffre
politique béant où seule la vaillante Jeanne d’Arc, au triste prix qu’on sait,
l’empêchera de s’engloutir.
Jean Fouquet. Heures d’Étienne Chevalier.
Saint
Jean à Pathmos. Utilisation du nombre d’or.
Chantilly.
Musée Condé.
Dans ce contexte instable,
troublé, violent même, Fouquet reçoit sa formation de peintre entre 1440 et
1450, au sein d’un atelier tourangeau ou angevin du Gothique international[4]. Pendant un voyage en Italie, il portraiture le pape Eugène IV[5]. Les contemporains louent
la stupéfiante ressemblance du tableau. Cet original aujourd’hui perdu survit
sous forme de deux faibles copies, qui ne permettent pas d’en apprécier
l’exceptionnelle qualité. Probablement Jean Fouquet rencontre-t-il, à Rome et à
Florence, des artistes en vue dont le grand Fra Angelico. De ce séjour au-delà
des Alpes, il rapporte en France la science alors nouvelle de la perspective,
qu’il est le premier de nos peintres à maîtriser. Il en adoucit toutefois la
rigueur mathématique par souci esthétique ; ainsi pratique-t-il une
perspective curviligne qui vaut signature. Par ailleurs, il utilise
systématiquement le nombre d’or.
Hérité des Grecs anciens, ce rapport géométrique observable dans la nature
renfermerait des proportions idéales, d’essence divine.
Jean
Fouquet. Pietà de Nouans.
Nouans
les-Fontaines (Indre-et-Loire). Église Saint-Martin.
Chef d’un atelier prospère
travaillant pour le pouvoir royal, la haute aristocratie et la bourgeoisie
fortunée, Jean Fouquet enlumine de remarquables manuscrits, parmi lesquels le
célèbre Livre d’heures d’Étienne
Chevalier (1452-1460), hélas aujourd’hui démembré[6], et les Grandes chroniques de France
(1455-1460). Il exécute aussi des panneaux peints : le Portrait de Charles VII
(1450-1455) ; le Diptyque de Melun
(1452-1458), tableau votif lui aussi dispersé, où la favorite royale Agnès
Sorel[7] aurait prêté ses traits à
la Vierge Marie ; la Pietà de Nouans
(1450-1460), fragment d’un retable monumental... Fouquet meurt entre 1478 et 1481,
peut-être à Tours. Il est l’exact contemporain de Louis XI[8].
Jean
Fouquet. Portrait de Charles VII.
Paris.
Musée du Louvre.
La critique retient de son art
le réalisme soucieux de vraisemblance propre aux maîtres flamands, tempéré d’un
désir typiquement français de clarté mêlée d’élégante retenue, enrichi par la
science italienne de la géométrie. Jean Fouquet assure la transition du
Gothique finissant à la première Renaissance. La pénétration psychologique de ses portraits se lit à livre
ouvert. Examinez, comme il a dû le faire mine de plomb en main, le visage terne
du roi Charles VII. Voyez ces traits tirés, tombants et las ; ce regard
qu’embrume une songerie perdue dans le vide ; ces petits yeux cernés, sans
éclat ni bonté ; ce long nez rougeaud et sensuel, dépourvu de grâce ; ces
lèvres épaisses, charnues mais serrées, à la moue renfrognée : ne
percevez-vous pas, comme moi, l’haleine fétide d’un hépatique chronique ?
Jean Fouquet. Heures d’Étienne Chevalier.
L’illumination des fidèles par le Saint-Esprit.
Chantilly. Musée Condé.
Particulièrement attentif aux
textes liturgiques qu’il doit illustrer, Fouquet sait en extraire des
éléments-clefs que ses prédécesseurs ont négligés. Ainsi, dans le Livre d’heures d’Étienne Chevalier, une
lanterne flotte sur la Colombe sacrée pour traduire l’Illumination des fidèles par le Saint-Esprit. Sa virtuosité
éblouit, comme en fait foi une paradoxale aptitude à rendre l’ombre par de
fines hachures d’or. Délicat, riche et frais, le chromatisme de ses miniatures
enchante l’œil : rien de plus exquis que cette harmonie de roses, verts,
bleus et blancs… Son goût pour la narration invente des mises en scène à la
fois naturelles et savantes, qui tour à tour abritent la tendre intimité d’une Vierge à l’Enfant ou animent une foule
compacte et gesticulante échappée des mystères
médiévaux. Il se dégage de ces compositions magistrales une singulière
grandeur, une harmonie déjà classique que n’eût pas reniée Louis XIV, une
poésie à la sensibilité préromantique.
Un éditeur scrupuleux et courtois
Léon Curmer a rédigé
l’introduction de cette monographie consacrée à Jehan Foucquet, dont il pare le prénom d’un H et le patronyme d’un C
selon l’usage médiéval[9]. Mettant en avant le
respect dû à ses lecteurs, il envoie une épreuve de son texte à un certain Monsieur Denis[10].
S’agit-il d’un correcteur d’imprimerie ? D’un libraire qui, au besoin, lui
prête obligeamment quelque ouvrage? D’une relation suffisamment ancienne pour
qu’il se permettre de l’appeler, avec confiance mais non sans une certaine
familiarité, Mon cher Monsieur Denis ?
Ce correspondant connaît déjà le projet éditorial puisque l’éditeur ne juge pas
nécessaire de nommer son futur ouvrage. Il lui enjoint de relire sans indulgence. Au passage, on remarque
sa courtoise modestie : il n’hésite pas à s’effacer devant un homme dont il
sollicite le concours.
Nous ne
mettons pas en doute le soin scrupuleux dont s’acquitta de sa tâche ce brave Monsieur
Denis. Blanchisseur occasionnel des papiers de Léon Curmer, fut-il aussi l’arrière-grand-père
d’une regrettée vedette des machines
à laver[11], dont
le rustique C’est ben vrai, ça ! enchanta
les téléspectateurs des années 1970 ? Une chose est sûre : le zèle du Père Denis a laissé échapper, au
vingt-troisième paragraphe, un pléonastique ordre
chronologique des temps – ce savon
temporel lui aura glissé des mains... Il n’a pas non plus empêché qu’à
l’antépénultième paragraphe, une faute entache des chefs-d’œuvres dont le dernier terme est invariable, aujourd’hui
comme il devait déjà l’être pour l’impératrice Eugénie, férue des dictées que
Mérimée truffait de chausse-trapes et autres délices orthographiques.
Quant à l’éditeur, on observe à
quel point il sait laisser parler ses sentiments, et combien cette sincérité résonne
avec naturel : mon cœur ; bien affectueusement. Léon Curmer, homme
de cœur…
Heureux possesseur de l’Œuvre de Jehan Foucquet, j’en transcris
pour vous l’introduction. Ceux qui la liront in extenso ont d’avance droit à une reconnaissance égale au temps (chronologique, cela va sans dire) passé
en dactylographie. Ceux qui la parcourront en diagonale ou, pire,
l’esquiveront, s’en expliqueront avec l’auteur dans l’éternité (chronologique des temps, naturellement).
INTRODUCTION
À toutes les
époques de l’histoire de l’art, chez tous les peuples qui, parvenus à divers
degrés de civilisation, se sont appliqués à exprimer et à manifester au dehors
leur pensée, c’est toujours sous l’inspiration religieuse que l’art s’est formé
et qu’il a produit ses premières œuvres. Or, entre toutes les manifestations, ingénieuses
ou savantes, qui reflètent et ennoblissent à la fois l’esprit humain,
l’architecture, par la majesté de la conception et la magnificence de
l’exécution extérieure, tient assurément le rang le plus ancien et le plus
imposant.
Les monuments de
la plus haute antiquité, tels qu’il nous est permis de nous les représenter à
distance, et ceux que la religion chrétienne a élevés plus tard, – les églises gothiques particulièrement, – ramènent, avec
une sorte d’autorité éloquente, par leur caractère grandiose et sévère, l’âme à
la foi et l’homme à Dieu.
Montaigne, dans
la verdeur de son naïf langage, a pu dire avec vérité : « Il n’est d’âme revêche qui ne se sente
touchée de quelque révérence à considérer la vastité sombre de nos églises, la
diversité d’ornements, et ouyr le son dévotieux de nos orgues et l’harmonie si
posée et religieuse de nos voix. »
Il est donc
facile de reconnaître le rang que l’architecture, la peinture et la sculpture
occupent dans l’histoire de l’art.
Si rien n’égale
l’impression de recueillement qu’éprouve l’homme en entrant dans une de ces
majestueuses basiliques élevées par la piété de fidèles à la gloire de
Dieu ; si la pensée humaine atteint ses dernières limites en contemplant
les ruines de la Cène, ce merveilleux
chef-d’œuvre dans lequel LÉONARD DE VINCI a résumé le Christianisme tout
entier, l’âme n’est-elle pas pénétrée d’un aussi profond sentiment de respect
en contemplant ce sanctuaire du Vatican où RAPHAEL dans la Transfiguration, le CARACHE dans l’Assomption de la Vierge, le DOMINIQUIN dans la Communion de saint Jérôme, ont réalisé tout ce qu’il est donné à la
peinture d’exprimer d’idéal ? La sculpture n’exerce pas un moindre empire
sur l’intelligence de l’homme, quand elle la force, malgré elle, à s’incliner
devant le Moïse de MICHEL-ANGE, ce
marbre sublime où le génie a incarné l’art dans toute sa grandeur et sa
majesté.
Comment ces
étonnantes conceptions, se complétant l’une par l’autre dans un engendrement
d’idées immédiat, sont-elles arrivées à un tel degré de perfection ?
D’où cette
perfection a-t-elle tiré son origine ? et pourquoi les émanations du génie
humain se sont-elles produites dans un pays plutôt que dans un autre ?
C’est ce que
l’histoire et la tradition nous enseignent.
Les Égyptiens
paraissent avoir consacré à leurs dieux de gigantesques monuments qui, dans
leurs pyramides et leurs temples, nous ont légué le témoignage de la vénération
religieuse en confirmant cet axiome : « La lumière nous vient de l’Orient. »
Les civilisations
de la Perse et de l’Inde ont engendré des systèmes artistiques qui étonnent, et
qui, sortis du sol, se sont successivement répandus chez les peuples de
l’extrême Orient.
D’autre part,
des migrations ont porté en Étrurie et en Grèce les connaissances qui s’étaient
développées dans le centre de l’Asie.
Nous savons
comment l’Empire Romain, après avoir conquis le monde, était devenu un centre
d’où rayonnait la lumière de l’intelligence et du savoir.
Le nouvel empire
d’Orient, par les soins de Constantin et de Justinien, a résumé et créé cet art
nommé byzantin, qui se perpétua dans
les cloîtres et se propagea dans les Gaules.
Jusqu’au XIVe
siècle, d’immenses travaux avaient été organisés au sein de nos villes et de
nos monastères ; il nous en reste comme principal témoignage ces
manuscrits précieux à tous les titres, qu’on peut consulter, grâce à la
libéralité des idées modernes, qui captivent notre admiration à un si haut
degré, et vers lesquels une étude sérieuse s’est portée enfin.
Au XVe
siècle, notre art national se développait dans toute sa magnificence. Ce fut au
centre de la France, dans la contrée la plus favorisée par l’aménité du climat,
que se forma une école définie sous l’enseignement d’un homme éminent par la
science, par le talent et par le génie.
Nos architectes
avaient élevé les temples splendides, nos peintres en avaient décoré les
murailles, nos sculpteurs avaient consacré le martyre des saints et les vertus
guerrières des héros qui avaient étendu le sentiment religieux par le
dévouement ; notre art était complet et allait se produire dans sa plus
haute expression.
FOUCQUET fut le
chef d’une école qui résuma toutes les écoles de notre pays en profitant de six
siècles d’études, et qui étendit au loin son influence et son empire.
Jean
Fouquet. Diptyque de Melun. Autoportrait.
Paris.
Musée du Louvre.
L’action morale
qu’elle exerça rayonnant sur toute la France et une partie de l’Europe, elle
produisit de vastes résultats, mais seulement actuels, et qui n’eurent sur
l’avenir qu’une influence limitée. Si cette manifestation resta improductive,
c’est qu’à son départ elle fut paralysée par l’insuffisance même de ses moyens
d’action ; la peinture à l’huile
était alors un procédé encore peu connu et peu pratiqué ; le peintre, si
élevées que fussent ses conceptions, n’avait pour les exprimer que la gouache sur vélin, et ses travaux,
concentrés nécessairement entre quelques mains d’élite, se trouvaient renfermés
dans des livres d’heures, rares manuscrits qui, après tout, restèrent oubliés
dans le sanctuaire de grandes familles ou négligés sur les rayons des
bibliothèques.
Une autre cause
de l’obscurité dans laquelle Foucquet est tombé doit être attribuée cependant à
ce fait si important et si déplorable pour l’école française, du triomphe de la
Renaissance italienne sur la Renaissance française.
L’Italie,
couverte de monuments antiques, mise en communication directe avec la Grèce,
était placée merveilleusement pour la culture des arts ; les deux
Bizzamano[12]
et Barnaba[13]
étaient venus de Constantinople et avaient fondé cette école de Sienne qui
produisit Guido de Sienne et engendra les écoles florentine et vénitienne.
Cimabué est leur fils. L’art, par cette transmission, se trouvait restauré sur
le sol de l’Étrurie et de l’Ombrie ; mais il faut avouer que, si les
travaux de Cimabué furent glorieux pour la peinture en Italie, nous aussi
Français nous avons notre art national : « En France, ainsi que l’atteste Félibien[14], l’art du dessin, introduit pas des
migrations qui se perdent dans la nuit des temps, s’y maintint même dans les
siècles barbares et y avait fait autant de progrès que dans toute l’Italie. »
Nous préparions une Renaissance qui devait nous être propre ; nous avions
créé l’architecture gothique ; un genre particulier de sculpture nous
appartenait ; nos moines, nos enlumineurs laïcs, avaient exécuté de
splendides manuscrits ; leurs travaux avaient produit l’Évangéliaire de Charlemagne, celui de l’ancien monastère et prieuré de
Saint-Martin-des-Champs, celui de Saint-Médard
de Soissons, la Bible de saint Martin
de Tours, offerte à Charles le Chauve, qui datent des VIIIe et IXe
siècles, et tant d’autres.
Jean
Fouquet. Diptyque de Melun. La Vierge à l’Enfant.
Anvers.
Musée royal des Beaux Arts.
Vers 1450, nos
conceptions antérieures se résument dans cette école de Tours dont Foucquet fut
le chef ; il est le plus grand peintre de notre moyen-âge expirant ;
il reste isolé, mais ferme sur son seuil : il devait être pour notre
future Renaissance ce que Fra Angelico
et le Pérugin ont été pour la
Renaissance italienne. Cette supériorité nous est attestée par la puissance de
ses productions, qui avaient pour rivales les écoles flamande et hollandaise,
écloses sous la protection des ducs de Bourgogne.
Si cette
succession de progrès de l’art est logique et rationnelle, si Foucquet se
montre le digne héritier de tant de maîtres glorieux, il n’y a nulle témérité à
répéter ce qu’Artaud[15] disait
à propos d’une situation analogue en la personne de Raphaël : « Il n’est à coup sûr pas tombé tout
à coup du ciel pour illustrer le siècle de Jules II et de Léon X ; son
talent est l’addition de tous les talents qui avaient existé
précédemment. »
Jean
Fouquet. Heures d’Étienne Chevalier.
La
Trinité.
Chantilly.
Musée Condé.
FOUCQUET, dans
l’ordre chronologique des temps (sic),
nous semble le précurseur d’un Raphaël français… Raphaël qui n’est point venu…
laissant notre Renaissance nationale sans couronnement.
Dès l’âge de
vingt-sept ans, Jehan Foucquet occupait en France le premier rang ; nourri
des études sérieuses qu’il avait faites sur les trésors que lui laissaient les
diverses écoles françaises, une heureuse circonstance lui permit de les
compléter par des études analogues sur les écoles italiennes. La faveur du pape
Eugène IV, qui voulait avoir son portrait de la main du peintre français,
l’appelait à Rome. Foucquet revint en France mûri par ces enseignements, et il
dota l’école de Tours du fruit de ses travaux. L’influence de ce séjour en
Italie reparaît dans chacune des œuvres qu’il exécuta en France jusqu’à sa
mort.
Nous réunissons
avec une piété respectueuse ces œuvres oubliées pendant un temps, mais que la
Renaissance italienne n’a point éclipsées.
Foucquet fut le
dernier et le plus méritant de nos peintres nationaux ; il est aussi grand
que la plupart des peintres italiens ses contemporains. Pendant que les écoles
de Cologne et de Bruges, toutes florissantes, se glorifiaient du nom de VAN
EYCK, nos écoles de France, Douai, Dijon et Tours, se résumaient elles-mêmes dans
le nom de FOUCQUET, pour former un centre digne de se présenter sous le nom de
Renaissance française.
Nous ferons
remarquer, pour l’honneur de Foucquet, qu’antérieurement à PÉRUGIN et à
RAPHAEL, il avait traité d’une manière magistrale le sujet du Mariage de la Vierge, et que les
chef-d’œuvres (sic) de ces divins
maîtres ont laissé dans tout son éclat la gloire de l’illustre chef de l’école
de Tours.
Jean
Fouquet. Grandes chroniques de France.
Le
supplice des Amauriciens en 1210.
Paris.
Bibliothèque nationale de France.
De nos jours,
des esprits éclairés, impatients de cette obscurité dont le voile s’est
appesanti sur les œuvres de Jehan Foucquet, ont cherché à le venger d’un oubli
si immérité. Nous avons recueilli ces essais et constaté les tentatives de ces
infatigables chercheurs, les maîtres de la science, de l’érudition et du bien
dire. Nous avons pu réunir toutes ces voix amies et répéter, grâce à leur
bienveillance, leurs justes appréciations de la vie et des œuvres de Foucquet.
Nous les reproduisons pour la seconde fois en les complétant et en leur donnant
une forme plus régulière ; nous nous sommes efforcé toutefois de conserver
la personnalité des critiques ; leurs opinions, disséminées dans des
écrits exposés à disparaître, reprendront, ainsi réunies dans le faisceau que
nous formons en l’honneur de Foucquet, toute la sève et la virilité qu’elles
avaient à leur origine.
Jean
Fouquet. Grandes chroniques de France.
L’hommage
d’Édouard Ier d’Angleterre à Philippe le Bel en 1286.
Paris.
Bibliothèque nationale de France.
Quelques
critiques, amateurs de grandes toiles, ont reproché à Foucquet, en lui donnant
avec dédain la dénomination de miniaturiste,
de n’avoir fait que des sujets de petite dimension. En repoussant ce mode
d’appréciation à la toise, nous
renvoyons ces critiques à l’examen sérieux des peintures de Foucquet, si larges
par la composition et par une disposition des personnages aussi ingénieuse que
magistralement ordonnée.
L.
CURMER.
Des vues artistiques singulières
Avouons-le tout net : ce texte
nous semble longuet ! On comprend les scrupules qui poussèrent son auteur à
le faire relire. Léon Curmer tarde à entrer dans le vif du sujet. Avant
d’aborder Jean Fouquet presque à mi-texte, il juge utile de dresser, depuis
l’Égypte antique, un panorama de la production artistique humaine dont il relie
l’essence à un besoin d’élévation morale, voire d’inspiration divine. Ces vues,
qui méconnaissent l’existence d’un art profane, n’engagent que leur auteur. S’ils
l’étonnent, les systèmes artistiques dont il gratifie la Perse et l’Inde nous font
sourire. Il omet tout bonnement l’apport capital de la civilisation chinoise. La
critique artistique actuelle repose sur une méthode différente : laïque, objective,
scientifique même, elle procède par regroupements et comparaisons.
Si chère à son époque, la
langue fleurie que pratique Léon Curmer a vieilli et n’est plus la nôtre. Cette
propension à enchaîner des propositions relatives allonge les phrases comme à
loisir. Elle rend la lecture plutôt laborieuse et empêche trop souvent de
saisir instantanément la pensée.
Certes, l’auteur met en
évidence le chef de file qu’incarne Jean Fouquet et la féconde postérité qu’il
a suscitée. Il souligne à juste titre – rendons-lui cet honneur – la puissance de ses
productions qu’il perçoit, avec pertinence, comme magistralement ordonnées. On peut toutefois regretter qu’il n’en
dégage pas assez le caractère novateur par sa maîtrise de la géométrie et de la
perspective, sa science du dessin et de la couleur, son invention dynamique.
Par contre, on retient le
caractère précurseur de son admiration sans borne pour l’enluminure. Les goûts
de ses contemporains s’orientent bien davantage vers les œuvres de chevalet et
les vastes compositions classiques ou baroques, que les Parisiens vont admirer
le dimanche au Louvre. La peinture sur vélin n’intéresse alors guère qu’un
cercle restreint de collectionneurs fortunés.
Un homme vieillissant
Mais revenons à la lettre qui
nous occupe. Son écriture s’avère révélatrice, comme déjà observé en janvier
2013 à propos d’un billet rédigé sept mois plus tard, durant l’Exposition
universelle de 1867.
L’orthographe présente
d’amusants archaïsmes. Le plus frappant se rencontre dès la première ligne,
avec le Y de cy joint qu’on ne trouverait déjà plus sous la plume de Louis XV.
Il en va de même pour l’excellens de
l’avant dernier paragraphe. Léon Curmer paraît ignorer la réforme de l’orthographe française de 1835[16],
alors pourtant vieille d’un quart de siècle, qui
prescrit, entre autres, d’employer un T
au pluriel de mots finissant par AN
ou EN – jusqu’alors, on a écrit en toute correction des enfans innocens.
On observe
aussi le tracé particulier, en forme d’accent circonflexe, de certains S finaux (vous, à la septième
ligne ; les [moments], à la dernière ligne de la
première page ; utiles, à la dernière ligne précédant la
formule de politesse ; dans, à l’avant-dernière ligne).
Archaïsant lui aussi, il se rencontre au début du XIXe siècle puis
disparaît peu à peu dès la Monarchie de Juillet.
Quant
à la graphie, nous la qualifierons de petite, régulière et dextrogyre[17].
Rapide, filiforme et liée, elle semble traduire une vivacité mentale capable
d’impatience. Paraissant s’interrompre par moments, elle manifeste aussi comme
une lassitude, visible par exemple dans les hampes plongeantes de la signature.
Le billet est
bref – deux feuillets recto-verso d’un petit in-folio. Manifestement pressé de l’expédier, l’auteur ne l’a pas
relu. En font foi les négligences d’accentuation (séverité, au premier
paragraphe ; indiscretion, au deuxième ; devoué,
dans la formule de politesse) et de
ponctuation (certains points finaux font défaut).
Pour finir, jetons
un coup d’œil au papier à en-tête. Soigné, il sort des presses de Jules Claye (Paris
1806 – 1886), qui imprime la plupart des œuvres de Victor Hugo. Particulièrement
chargé aussi, il tient à la fois du catalogue d’exposition et de la carte de
visite. Ceci dit, il fournit de précieux renseignements sur l’historique des
publications de l’éditeur, à la réserve de son
obsolescence car Les Évangiles ont paru
en 1864 – prévoyant, l’épistolier aura vu
large dans sa dernière provision de papier d’affaires. Il nous éclaire aussi
sur un certain mode de vie. Léon Curmer ne se rend à son magasin que trois
jours par semaine et n’y reste que deux petites heures. L’aisance financière
rend-elle accessoire la vente de ses livres, distribués chez des libraires ? Souhaite-t-il
ménager le temps nécessaire à ses recherches sur l’histoire de l’art ? Fatigué,
peut-être même déjà souffrant, a-t-il volontairement ralenti son
activité ?
* * *
* *
*
Que retenir de cette missive ?
Le respect scrupuleux de ses
lecteurs, qui pousse un homme destiné au notariat, maniant depuis toujours la
plume avec aisance, à se faire relire par un tiers. Et un touchant exemple de
modestie, qui devrait inspirer notre époque volontiers dupe de la forfanterie.
En traçant ces lignes, Léon
Curmer sait-il qu’il n’éditera plus aucun livre ? Sa carrière est écrite
et bien remplie ; probablement ne l’ignore-t-il pas... La maladie
l’emportera trois ans plus tard, au terme d’une existence toute dévouée à son
métier – son art, comme il le revendique. Ressent-il
les prodromes du mal douloureux, hélas incurable, qui va le ronger ? La
main continue de courir sur le papier, légère, rapide et ferme, mais elle doit
parfois s’arrêter pour reprendre forces et élan.
Le hasard des sites d’enchères
– mais en est-ce-un ? – a mis sous mes yeux,
concomitamment à cet émouvant autographe, celui d’une femme de lettres
adressant à Léon Curmer un amer reproche d’ingratitude. Cela inspirera
peut-être un prochain billet éclairant l’illustre éditeur – ou bien sa correspondante,
depuis longtemps ensevelie dans les ténèbres de l’oubli – sous un jour inattendu. Telle cette lanterne
céleste allumée, voici plus d’un demi-millénaire, par le peintre Jean Fouquet.
Thierry
COUTURE
21
mars 2021
[1] Élisabeth (dite Isabeau)
de Bavière (Munich, vers 1370 – Paris, 1435) épouse Charles VI en 1385. Dès
1392, ce dernier souffre de graves crises de démence ponctuées de rémissions,
d’où son surnom le Fou. Cette
situation inédite propulse la reine sur la scène politique. Les historiens
restent divisés sur le bilan de sa régence. À raison semble-t-il, les
contemporains lui prêtent une liaison amoureuse avec son beau-frère, le
fringant duc Louis d’Orléans, assassiné à Paris en 1407.
[2] Philippe le Bon (Dijon, 1396 – Bruges, 1467) reste profondément affligé
par l’assassinat de son père Jean sans Peur, en 1419, sur le pont de
Montereau-Fault-Yonne. En signe de deuil, il ne se vêt plus que de noir. Lors
du meurtre, le duc Jean est accompagné du futur Charles VII, que Philippe
tiendra pour responsable.
[3] Charles VII (Paris, 1403 – Mehun-sur-Yèvre, 1461) devient
roi de France en 1422, à la mort de son père Charles VI. Son long règne
restaure l’autorité royale, mise à mal par les troubles politiques. L’argentier
Jacques Cœur raffermit l’économie, ce qui n’empêchera pas sa disgrâce. Les
historiens critiquent l’ingratitude du roi à l’égard de Jeanne d’Arc, qui l’a
fait sacrer à Reims en 1429. De fait, il ne tente rien pour délivrer la Pucelle
prisonnière des Anglais, brûlée vive deux ans plus tard à Rouen comme
hérétique. En 1435, il signe avec son cousin Philippe le Bon le traité d’Arras,
qui met fin à la guerre civile entre Armagnacs
(partisans du pouvoir royal) et Bourguignons (alliés des Anglais). En 1453, la bataille de Castillon accomplit le
vœu de Jeanne d’Arc et boute l’ennemi hors de France. La postérité surnomme Charles VII le Victorieux ou le Bien servi. Il laisse à son fils, le rusé Louis XI, un royaume libéré, pacifié et
prospère.
[4] Phase tardive du Gothique, qui se répand en Europe occidentale entre la
fin du XIVe et le début du XVe siècles. Elle se
caractérise par une élégance raffinée mais précieuse, un souci accru du détail
et de la vraisemblance, une obsession macabre liée à l’épidémie de peste
noire. Elle traduit aussi une sécularisation
de l’art, dont la bourgeoisie devient commanditaire.
[5] Né Gabriele Condulmer (Venise, 1383 – Rome, 1447), Eugène IV
est élu pape début mars 1431, trois mois avant le supplice de Jeanne d’Arc. Sous son
pontificat, le concile de Bâle, qui se prolonge pendant dix ans, affirme sa
primauté sur le pouvoir papal et consomme la rupture entre les Églises d’Orient
et d’Occident. En 1435, Eugène IV publie une bulle, aussi visionnaire que
chrétienne, interdisant formellement l’esclavage. Par avidité, les puissances
européennes, Espagne en tête, ne la respecteront pas.
[6] Les miniatures à pleine page du Livre d’heures d’Étienne Chevalier, estimées à une cinquantaine, sont
découpées au début du XVIIIe siècle puis dispersées. Le Musée
Condé de Chantilly en conserve la majeure
partie, soit quarante peintures collées sur des planches de bois. D’autres se
trouvent à New-York, en Angleterre et dans plusieurs collections publiques
parisiennes. Au moins six ont disparu.
[7] Agnès Sorel (vers 1422 – Le Mesnil-sous-Jumièges, 1450) devient
maîtresse de Charles VII en 1443-1444. Elle inaugure la longue liste des
favorites officielles.
[8] Louis XI (Bourges, 1423 –
Plessis-lèz-Tours, 1483) succède à son père Charles VII en 1461, après
avoir comploté contre lui. Politique habile et souvent retors, ses
contemporains le surnomment le Prudent
mais aussi l’Universelle Aragne
(c’est-à-dire l’Araignée). En 1475,
il signe avec les Anglais le traité de Picquigny, qui met un terme définitif à
la guerre de Cent ans (il en plaisantera, affirmant : « j’ai chassé
les Anglais avec du vin et du pâté !). Soucieux d’affermir le pouvoir
royal, il lutte contre les grands féodaux. Mais à la mort de Charles le Téméraire
en 1477, il ne peut empêcher le passage des territoires bourguignons aux
ambitieux Habsbourg. Modernisant son royaume, il crée une poste, encourage la
culture du ver à soie et promeut l’imprimerie. Homme avisé œuvrant pour
l’avenir, il rassemble et agrandit ses terres. Les historiens actuels passent
outre la légende noire de sa superstition et de sa cruauté, traits communs à
son époque, et le tiennent pour l’un des plus grands rois de France.
[9] L’orthographe du patronyme restituée par Léon Curmer n’est
pas conforme à celle qu’adopte le peintre, qui signe JOH(ANN)ES FOUQUET le médaillon émaillé où il s’est représenté dans le Diptyque de
Melun.
[10] Ce nom n’apparaît pas dans la longue liste des
souscripteurs de l’Œuvre
de Jehan Foucquet. Par ailleurs, l’absence
de prénom et le caractère commun du patronyme dissuadent d’entreprendre une
recherche susceptible d’aboutir.
[12]
Mes recherches sur Internet ne m’ont permis de trouver qu’Angelo BIZAMANO, peintre crétois d’icônes actif de
1482 à 1539, bien après les débuts de l’École siennoise. Ces deux
Bizzamano évoqués par Léon Curmer gardent
donc leur mystère.
[13] Barnaba Agocchiari
dit Barnaba da Modena (Modène, vers 1328 – vers 1386), peintre italien de style
byzantin.
[14] André Félibien (Chartres,
1619 –
Paris, 1695), architecte et historiographe.
[15] Nicolas Artaud (Paris, 1794 – 1861), universitaire
et traducteur.
[17] Écriture qui penche vers la
droite, contrairement à la lévogyre. En associant deux termes l’un latin et l’autre grec, cet adjectif
penche du côté de la bâtardise. Dextroverse et lévoverse (ou sénestroverse) respecteraient bien davantage les règles
de l’étymologie.